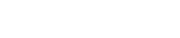- Genre des mots : théories et difficultés
La description des langues souffre alors de trois maux principaux : les outils d’analyse sont extrêmement sommaires; les grammairiens sont influencés par les concepts forgés pour les langues antiques (notamment le latin dont ils ont une pratique assidue), qui sont difficilement applicables aux langues vernaculaires; et l’idéologie vient constamment influencer la pensée.
La citation ci-dessous montre que l’auteur 1) tente de décrire la différence entre les finales masculines des noms ou des adjectifs, qui en français sont le plus souvent vocaliques (meunié, heureu, cousin) et leurs correspondantes féminines, qui sont le plus souvent consonantiques (meunièr, heureuz, cousin’); 2) passe sans crier gare des finales à l’«indice» des noms, c’est-à-dire leur article (le, la); 3) décrit les sons d’après les impressions qu’ils lui suggèrent à travers l’idéologie sexiste; 4) mélange genre et sexe, l’idée de femme l’entrainant vers celle de sexe (Qu’est-ce de masculin genre? […] Qu’est-ce de Feminin sexe?)
-
Genre des mots : les interventions sur la langue
La langue est aussi influencée par l’importance croissante des femmes à la cour de France durant tout le XVIe siècle, qui voit s’amplifier un mouvement amorcé dans les cours régionales au siècle précédent. Chargées de l’animation de la cour, elles se saisissent des nouveaux mots féminins, elles réaniment le pronom elles que les clercs étaient en passe de faire disparaitre (cf. Villon dans la Ballade des dames du temps jadis: « Où sont ils, Vierge souveraine ? »), elles acclimatent le pronom attribut la (« je suis veuve et je la resterai »). Par ailleurs, certaines de ces femmes, ainsi que d’autres, issues de la bourgeoisie intellectuelle, tiennent salon, écrivent, font publier leurs œuvres. Elles commencent ainsi à investir la parole publique, un territoire pensé par la plupart des lettrés comme leur chasse-gardée.
Au XVIIe siècle, et surtout à partir de son milieu, la tendance s’inverse en partie, avec la disparition des femmes au pouvoir après Anne d’Autriche (†1666) et la création de l’Académie française par Richelieu (1635), exclusivement composée d’hommes de l’élite. Officiellement chargée de rendre la langue capable de tout exprimer, elle va surtout la normer (dans l’esprit des jardins à la française), la complexifier (pour permettre aux élites de se distinguer) et la «purifier» (des régionalismes, des créations de la Pléiade, des traces de l’influence des femmes). Les femmes de la cour demeurent néanmoins puissantes, les salons se multiplient, et certaines autrices remportent d’immenses succès de librairie.
La réflexion sur les genres, constamment parasitée par celle des relations entre les sexes et l’agacement des hommes de lettres face à l’avancée des femmes, pousse les grammairiens masculinistes à intervenir dans le domaine des noms communs de personne, notamment pour faire disparaitre ceux qui désignent les activités qu’ils jugent propres à leur sexe : la pensée, le jugement, la création, le savoir (voir, dans la rubrique des noms de A à Z, les mots autrice, médecine, peintresse, poétesse). Ces mots sont condamnés dans les ouvrages sur la langue et les grammaires, et ils ne sont pas mentionnés dans les dictionnaires de langue, notamment celui de l’Académie (dont le premier parait en 1694). Mais ils continuent d’être utilisés par les locuteurs et locutrices.
À côté des noms communs de personne, une attention toute particulière est donnée au pronom attribut la, qui s’était installé dans les usages, et que les grammairiens du «grand siècle» veulent absolument éradiquer (voir la rubrique Accords: accord du pronom personnel attribut). On observe aussi que les lettrés les moins influencés par la cour continuent d’utiliser des pronoms masculins pour parler des femmes, comme le montrent les citations suivantes.
Privilège pour Brutus de Catherine Bernard
Dans la citation suivante, extraite d’un livre qui se présente comme un dialogue entre un grammairien et un homme désirant s’instruire, l’auteur condamne fermement le pronom la, commençant par affirmer qu’il n’est jamais employé. Sachant que la réalité lui donne tort, il met en scène la surprise de son interlocuteur, avant de lui répondre. Son incapacité à justifier la condamnation du pronom se marque 1) par la confusion de son explication, 2) par une charge contre les femmes en général (« le Sexe »), qui seraient trop fières d’elles (elles sont « jalouses de leur genre ») et voudraient modifier le genre de certains termes – en réalité : intervenir dans le débat entre lettrés et d’appuyer certaines options (quand elles s’imaginent avoir raison), 3) par le point final mis au débat de la discussion, . Cette attaque s’inscrit dans la critique des « précieuses », connues pour discuter de la langue.
– 1690 :
« B. — (Le) se trouve devant le Verbe Etre; mais (la) ni (les) ne s’y trouvent jamais.
C. — La Raison ?
B. — Parce que la Reponse se fait en General & non en Particulier, comme : Etes vous celle ou celles que nous cherchons ? L’on répondra tres-bien, je le suis, ou nous le sommes & jamais je la suis, ni nous les sommes ? car on entend par cela, je suis ou Nous sommes ce que Vous desirez de sçavoir.
C. — Je pense neanmoins de l’avoir ouï dire.
B. — Cela se peut car le sexe étant jaloux de son genre, se sert du feminin en toutes les occasions où il pense avoir quelque peu de raison, comme: en Ouvrage, Amour etc. qu’il fait féminin, quoi qu’ils soient Masculins »
François de Fenne, Entretiens familiers pour les Amateurs de la langue françoise, Leyde, chez Corneille Boutesteyn (Slatkine reprints, 1973), Entretien IX, p.44-45.
En l’occurrence, amour est encore massivement féminin à cette époque (cf. Racine : « Je plains mille vertus, une amour mutuelle,/ Sa pitié pour moi, ma tendresse pour elle », Iphigénie I,1). Ouvrage au féminin sera condamné avec des connotations sexistes et classistes jusqu’à la fin du XXe siècle (Paul Dupré, L’Encyclopédie du bon français…, 1972 : « Dans le langage populaire ou plaisamment, on le met au féminin »).