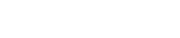Compte rendu de l’ouvrage de Mireille Huchon
Parmi les récentes études sur Louise Labé, cet essai met franchement en doute, dès le titre, l’existence même de la personne. Mireille Huchon se demande d’abord si la poétesse, dont l’œuvre complète, parue en 1555, disparaît l’année suivante, pour ne réapparaître qu’après plus de deux siècles (1762), est ou n’est pas la personne de même nom, fille de Pierre Charly (dit Labé), le maître de la corderie Labé, représentant des cordiers lyonnais, elle-même riche propriétaire d’édifices et de domaines; la personne née entre 1516 et 1523, qui meurt entre le 28 avril 1565 (date de son testament) et le 30 août 1566 (date de la commande d’une pierre pour son tombeau). L’auteur de l’essai se demande ensuite si Louise Labé est bien ou non la personne connue comme la Belle Cordière: la Cordière de Lyon, que Philibert de Vienne en 1547 dit honorable; signalée dans une topographie scénographique de Lyon des années 1545-1550 avec l’indication R. Belle Cordière; la courtisane célébrée en 1555 comme la belle Cordière de Lyon par François de Billon dans son Fort inexpugnable de l’Honneur du Sexe Femenin; ou la Belle Cordière que Calvin déclare en 1561 «plebeia meretrix». On a, bien sûr, des perplexités à croire que la riche Madame Labé est une courtisane, mais il est bien plus difficile d’accepter que l’on puisse comparer la Belle Cordière (au sens de Dame de la bien connue et riche famille Labé) à la Belle Heaulmière (qui certes n’était pas une Dame d’une famille produisant des heaumes) et aux autres simples filles de joye de Villon (citées aux pp. 129-130). Ces doutes, nourris par une relecture des textes historiques de référence, et surtout par une analyse minutieuse des 25 Escriz de divers Poëtes, ont amené Mireille Huchon à proposer une ingénieuse subversive conjecture: Louise Labé, poétesse lyonnaise, est une créature de papier (titre de l’essai). Elle n’existe que comme supercherie littéraire (titre de p. 141), sous la forme d’un personnage-écrivain inventé, désigné comme auteur d’une œuvre, en réalité collective: une admirable érudite gaillardise (titre de p. 228), organisée par les savants correcteurs de l’atelier de Jean de Tournes (titre de p. 172), à savoir des intellectuels lyonnais du cercle culturel de Maurice Scève. Il est bien vrai que d’autres critiques avaient déjà signalé de probables suggestions et corrections (habituelles à l’époque), tendant à modifier sous presse l’œuvre de la poétesse. Mais, si la conjecture de la supercherie littéraire, niant l’existence de l’autrice, était vraie, cela voudrait dire que deux personnes historiques connues, Madame Labé, appartenant à la riche bourgeoisie lyonnaise, et la noble dédicataire de l’œuvre, Madamoiselle Clémence de Bourges, fille de Claude de Bourges, seigneur de Myons dans le Dauphiné, étaient d’accord avec les conjurés. Et que le bureaucrate responsable de la concession du Privilege du Roy participait lui aussi, amusé, aux savantes moqueries (titre de p. 228); ou autrement que, sans s’en apercevoir, mais avec toutes les possibles conséquences, il aurait déclaré solennellement, au nom du Roi de France: avoir accepté l’humble suplication de notre chere & bien aymee Louïze Labé Lionnoize, en réalité inexistante.
Le point de départ de Mireille Huchon (pp. 172-186) est un sonnet de Clément Marot (éd. posthume parue chez Jean de Tournes en 1546) adressé à deux jeunes poètes, les invitant à ne pas le louer, mais à louer Louise: «Laissez moi là: et louez moi Loyse»; louer–Louise, une paronomase modelée sur l’autre bien connue de Pétrarque, laudare-Laureta-laurea (ici bizarrement coupée: laudare-Laure, aux pp. 177, 186, 272; surprenante également est la correction, ‘laudare Laura‘, apportée par Marc Fumaroli dans sa recension favorable de l’essai; ce qui a probablement suggéré à Édouard Launet une sorte de traduction, ‘louer Laure‘, et à Bernard Plessy une sorte de bizarre explication, ‘lau(da)re Laure‘, dans leurs interventions). C’est la célèbre paronomase qu’on lit dans le sonnet V du Canzoniere de Pétrarque: il s’agit, on le sait, de la célébration du nom de la Bien-aimée, nom prononcé dans trois soupirs successifs (chaque soupir une syllabe: LAUdando s’incomincia (…) || REal, che’incontro poi (…) || ma: TAci, grida il fin), suivis de trois autres soupirs (Così LAUdare e REverire insegna || (…) forse Apollo si disdegna). Selon la lecture qu’en faisait dans sa biographie du poète, son contemporain et ami Boccace, les trois premières syllabes, LAU|RE|TA, forment le diminutif provençal de Laure; les trois autres, LAU|RE|A, évoquent la couronne de laurier (lauro) destinée au poète. Le nom de la Dame (Laureta) contient donc la louange (laude) du poète à sa Bien-aimée et la coronne de laurier (laurea) à laquelle il aspire. La paronomase de Marot (mort en 1544) serait le mot d’ordre des conjurés participant (en 1555) à la gaye fantaisie (titre de p. 207) se proposant de louer une Loyse ou Louise, nom féminin, qui d’ailleurs ne serait pas, ainsi que pour Pétrarque, une angelica forma se résumant en un nom, mais une personne en mesure d’écrire, de laisser des traces. Le dizain des Estreines à Dame Louïze Labé (XIII des Escriz) serait «une évidente réponse» (p. 177) à l’invitation de Marot (mort depuis onze ans), réponse exprimée dans les deux derniers vers du dizain: «(…) je ne puis que Louïze ne loue || Et si ne puis assez louer Louïze.» Les conjurés se seraient accordés pour écrire des textes en vers et en prose, composer une œuvre, dont l’auteur imaginaire aurait un nom féminin (mais pourquoi choisir le nom d’une personne réelle, riche, connue, au lieu d’un nom inventé, tel par ex. Laure Labesse?): ce serait une poétesse française, en mesure de rivaliser avec les italiennes.
Dans sa Conclusion (pp. 271-175) Mireille Huchon affirme carrément que le livre attribué à Louise Labé est «un texte artificiel», «un laboratoire», «un véritable art poétique, avec des jeux très subtils, parodiques». Elle répartit les textes parmi les conjurés: Maurice Scève aurait composé le Débat, un autre (Charles Fontaine?) les élégies, Olivier de Magny les sonnets. Heureusement «l’existence de Louise Labé n’est pas en cause, même si elle ne fut qu’une femme de paille» (p. 275), «poupée désarticulée sur son lit mol de courtisane» (p. 275); au lecteur reste le goût de la lecture, «une pratique où le plaisir pur s’abstrait des contingences de la création» (p. 275). Certes, un texte, comme un cailloux poli par les courants, occasionnellement arrivé jusqu’à nous, peut se faire apprécier dans sa forme absolue. Certes, lire un texte c’est l’actualiser pour le goûter. Mais une lecture analytique doit permettre au lecteur de chercher à cueillir dans un texte tout ce qu’il contient: les mots dont il est fait, les structures syntaxiques et métriques le régissant, ses rapports avec les autres textes composant l’ensemble de l’œuvre, ses rapports avec d’autres œuvres, avec le milieu qu’évoque le texte, où le texte est né, les significations émergeant de tous ces signes. Une lecture analytique devrait montrer si l’écriture est l’expression d’une pensée personnelle ou un jeu, si c’est la création d’une forme nouvelle ou la parodie d’une forme préexistante. Au lieu d’attendre des découvertes occasionnelles pouvant «apporter quelques réponses, au moins partielles» (p. 238) à ces multiples questions, il vaudrait mieux sans doute analyser les textes pour connaître quelle personnalité émerge du livre attribué à Louise Labé; si les textes de l’ensemble sont sortis d’un même esprit ou de plusieurs, écrits ou non par la même main.
Quant aux deux sonnets, souvent cités par les critiques (cités à la p. 229), le II de Louise Labé, le LV des Soupirs d’Olivier de Magny (ici placés de façon à pousser le lecteur à lire celui de Magny le premier), dont les deux quatrains sont exactement les mêmes, est-il possible d’en reconnaître la paternité, par ex. en comparant les deux tercets, qui sont très différents’ Un simple lecteur pourrait-il considérer les six vers, assez plats, de Magny (1557), comme le modèle des six vers, hautement dramatiques, de Louise Labé (1555), qui seraient donc imités, mais ironiquement, par le conjuré Magny, pour la moquerie, «moquant tout aussi bien Louise Labé que Pétrarque» (p. 231)? Et encore, si l’on compare les deux autres sonnets (cités aux pp. 231-232, astucieusement placés, eux aussi), le III de Louise Labé (1555), le LXVI des Soupirs de Magny (1557), deux libres adaptations d’un sonnet italien de Iacopo Sannazaro (1530), on peut voir: dans le sonnet III une correspondance du rythme des vers, français et italiens, et quelque liberté dans le contenu; dans le sonnet LXVI un changement radical du rythme du vers (alexandrin), plus long, et une adhésion plus marquée au contenu du texte italien. Si le sonnet LXVI de Magny (au v. 12) nous montre le dieu Amour en train de sortir («Sus donc Amour, va t’en»), comme s’il s’agissait d’un petit chien obéissant, tandis que le sonnet III de Louise Labé (que le conjuré Magny devrait avoir écrit avant l’autre) occupe tout le premier tercet pour décrire Amour cruellement armé contre la poétesse imaginaire, cela pourrait-il signifier que le texte plus simple (postérieur) est authentique et sincère, et que l’autre (antérieur), amplifié dramatiquement, est volontairement surchargé d’images pétrarquistes (p. 233), et donc qu’il s’agit d’une moquerie ironique?
Paolo Budini (Francofonia, 52, 2007-2, p.130-137.)